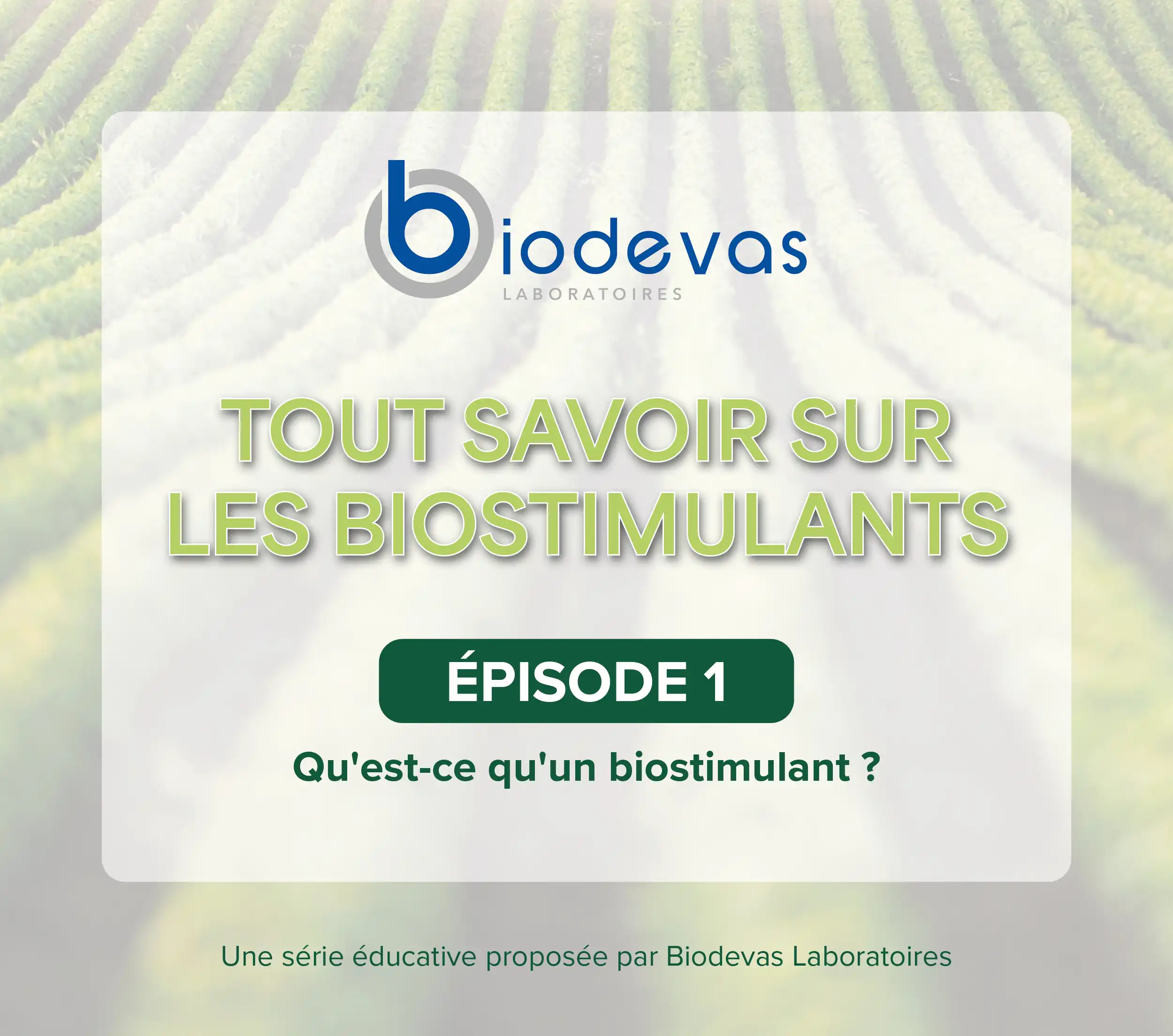Qu’est-ce qu’un biostimulant ?
Introduction

Face aux défis actuels de l’agriculture – hausse des rendements, adaptation climatique, réduction des intrants – les biostimulants apparaissent comme des leviers stratégiques.
Leur efficacité repose sur la stimulation de processus physiologiques clés comme la croissance racinaire, la régulation hormonale, l’optimisation de la nutrition minérale ou encore la tolérance au stress abiotique (Du Jardin, 1991).
Contrairement aux engrais, qui fournissent directement des nutriments, ou aux produits phytopharmaceutiques, qui ciblent des bioagresseurs, les biostimulants n’agissent pas de manière directe. Leur objectif est d’optimiser la physiologie de la plante afin d’améliorer ses performances globales (Calvo et al., 2014).
Origine et définition des biostimulants
Les débuts du concept (1990–2010)
Le terme “biostimulant” est apparu dans les années 1990. Dès 1991, ils furent décrits comme des substances capables de stimuler les fonctions biologiques des plantes à faibles doses, favorisant l’absorption d’eau et de nutriments (Du Jardin, 1991).
En 2006, lors de la conférence Biostimolanti in agricoltura en Italie, ils furent définis comme des “substances non fertilisantes appliquées en faibles quantités et capables d’améliorer la croissance végétale” (Biostimolanti, 2006).
En 2012, Patrick Du Jardin proposa une définition devenue référence : les biostimulants regroupent des substances ou micro-organismes qui, sans apporter directement de nutriments, améliorent la nutrition, la qualité et la tolérance au stress abiotique (Du Jardin, 2012).
Une reconnaissance réglementaire (depuis 2019)
Depuis 2019, l’Union européenne a adopté une définition officielle dans le Règlement (UE) 2019/1009, qui les classe dans la catégorie PFC6 des produits fertilisants. Un biostimulant y est décrit comme un produit stimulant les processus nutritionnels de la plante “indépendamment de sa teneur en nutriments”, avec pour objectif d’améliorer :
- L’efficacité d’utilisation des nutriments,
- La tolérance au stress abiotique,
- Les caractéristiques qualitatives des cultures,
- La disponibilité des nutriments dans la rhizosphère (Règlement UE 2019/1009).
Ce cadre réglementaire a légitimé leur usage et permis le marquage CE des produits conformes.
Un outil complémentaire, pas un substitut
Pour bien comprendre la spécificité des biostimulants, il faut les situer par rapport aux deux autres piliers de l’agronomie moderne :
- Les engrais apportent directement des éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium…).
- Les produits phytopharmaceutiques protègent les cultures contre des bioagresseurs (maladies, ravageurs, adventices).
- Les biostimulants, eux, agissent autrement : ils n’apportent pas de nutriments ni ne détruisent d’ennemis, mais optimisent le fonctionnement interne de la plante pour qu’elle valorise mieux les ressources disponibles et réponde plus efficacement aux contraintes environnementales.
Cette logique en fait des alliés précieux pour réduire la dépendance aux intrants chimiques, sans compromettre la productivité.
Pourquoi utiliser des biostimulants en agriculture ?
Renforcer la tolérance au stress abiotique

Les stress abiotiques (sécheresse, chaleur, salinité, gel) représentent aujourd’hui plus de 50 % des pertes de rendement agricole à l’échelle mondiale (FAO, 2022).
Les biostimulants activent des mécanismes de défense naturels : production de protéines de choc thermique (HSP), stimulation d’enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase et la catalase, ou encore accumulation d’osmolytes (proline, glycine-bétaïne) (Hayat et al., 2010).
Les extraits d’algues, riches en composés bioactifs, sont particulièrement étudiés. Ils stimulent la régulation stomatique et renforcent les mécanismes antioxydants, augmentant la tolérance à la sécheresse et à la salinité (Frontiers in Plant Science, 2021 ; Journal of Applied Phycology, 2019).
Optimisation de l’Absorption des Nutriments
Les biostimulants influencent à la fois la morphologie racinaire et l’activité microbienne de la rhizosphère. Les acides humiques et fulviques, par exemple, facilitent le transport des oligoéléments et améliorent la biodisponibilité du phosphore (Soil Science Society of America Journal, 2020).
Certains micro-organismes utilisés comme biostimulants favorisent aussi la sécrétion d’exsudats racinaires, qui mobilisent les nutriments peu solubles (Calvo et al., 2014). Cela se traduit par une nutrition minérale plus efficace, en particulier dans les sols pauvres en matière organique.
Réduire le recours aux intrants chimiques
En renforçant les capacités adaptatives des plantes, les biostimulants permettent de réduire les apports d’engrais et de produits de protection, tout en maintenant les performances agronomiques (Du Jardin, 2015). Leur rôle n’est pas de remplacer les intrants classiques, mais de les optimiser dans une logique de durabilité.
Quand et comment utiliser les Biostimulants ?

L’efficacité d’un biostimulant ne dépend pas uniquement de sa composition : elle repose aussi sur son positionnement dans le cycle de culture et sur le mode d’application choisi. Bien utilisés, ils deviennent de véritables outils stratégiques, capables de sécuriser le potentiel de rendement à différentes étapes.
- Au démarrage : certains biostimulants appliqués au semis ou lors de la transplantation stimulent l’enracinement et l’activité biologique du sol. Ils favorisent une installation rapide et homogène, réduisant les pertes liées aux stress précoces.
- Pendant la croissance active : des extraits végétaux ou hydrolysats de protéines soutiennent la vigueur foliaire et améliorent l’efficacité d’utilisation des nutriments. Ils accompagnent la plante dans sa phase de développement et optimisent la valorisation des engrais apportés.
- Aux stades sensibles (floraison, nouaison, grossissement des fruits) : l’application préventive aide la plante à mieux tolérer des aléas comme la sécheresse, la chaleur ou la salinité, grâce à l’activation de mécanismes internes de régulation.
- Avant ou après un épisode de stress : certains biostimulants appliqués en foliaire ou via fertirrigation favorisent la résilience et/ou la relance de la photosynthèse et de la croissance, limitant les pertes de rendement et de qualité.
Ces effets varient selon le type de produit (extrait d’algues, acides humiques, micro-organismes, etc.), mais aussi selon le mode d’application (enrobage de semences, fertirrigation, pulvérisation foliaire). L’enjeu n’est donc pas de suivre un calendrier universel, mais d’adapter la stratégie au contexte : type de culture, stade physiologique et conditions climatiques locales.
Conclusion
Les biostimulants constituent aujourd’hui un troisième pilier de l’agronomie moderne, complémentaire des engrais et des produits de protection. Leur valeur tient à leur capacité à :
- Accroître la résilience des cultures face aux stress climatiques,
- Améliorer l’efficacité d’utilisation des nutriments et de l’eau,
- Et contribuer activement à la durabilité des systèmes agricoles.
En mobilisant les mécanismes physiologiques naturels des plantes, ils ouvrent la voie à une agriculture capable de concilier performance, adaptation et respect des ressources. Plus qu’une simple innovation, ils représentent un levier stratégique pour préparer l’agriculture aux défis de demain.
Dans le prochain article, nous entrerons dans une approche plus scientifique et détaillée, en explorant les différentes familles de biostimulants – organiques et microbiens – et en analysant leurs modes d’action spécifiques. Cette plongée technique permettra de mieux comprendre comment ces solutions agissent concrètement au cœur de la plante et de sa rhizosphère.
Références bibliographiques
- Calvo, P., Nelson, L., Kloepper, J. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and Soil.
- Du Jardin, P. (1991). Biostimulants and their role in sustainable agriculture. Journal of Agricultural and Food Chemistry.
- Du Jardin, P. (2012). Biostimulants: Definition and Applications. Biostimulants in Modern Agriculture, Conference Proceedings.
- Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, categories and regulation. Scientia Horticulturae.
- FAO (2022). The State of Food and Agriculture.
- Frontiers in Plant Science (2021). Seaweed extracts in agriculture.
- Hayat, S., et al. (2010). Environmental and Experimental Botany – Role of salicylic acid under abiotic stress.
- Journal of Applied Phycology (2019). Seaweed extracts in agriculture.
- Soil Science Society of America Journal (2020). Biostimulants and nutrient use efficiency.
- Rouphael, Y., Colla, G. (2020). Biostimulants and crop quality improvement. Frontiers in Plant Science.
- Règlement Européen (UE) 2019/1009. Définition officielle des biostimulants.
Disclaimer
Cette série a pour objectif de partager des informations pratiques sur les biostimulants. Chaque mois, un nouveau thème sera abordé, sur la base de notre expertise et de nos recherches.
Des questions ? Contactez-nous, notre équipe est à votre écoute.